L’une des enquêtes du programme « Le français de nos régions », conduite avec la collaboration de Magali Bellot, alors étudiante en master à l’Université de Fribourg, portait sur les germanismes du français que l’on parle en Suisse romande. L’idée était de voir dans quels cantons – et dans quelles proportions – certaines tournures lexicales, empruntées à l’allemand ou au suisse alémanique, étaient employées par les Romands. Plus de 3.000 francophones de Suisse (ainsi que quelque 150 Français des départements de l’Ain, du Jura et du Doubs) ont répondu à la quarantaine de questions que nous leurs avions posées. Ils se répartissent de la façon suivante :

Figure 0. Répartition des participants à l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants.
Nous avons sélectionné pour ce nouveau billet 12 des cartes les plus représentatives des résultats.
Les premières cartes concernent les germanismes qui sont connus et employés par l’ensemble des Romands, d’où qu’ils viennent (sur ce genre de germanisme, v. aussi ce billet). C’est notamment le cas du mot boiler (prononcé « boileur »), ce qu’on appelle en France un « chauffe-eau » (le Dictionnaire suisse romand signale qu’on le trouve également en Alsace et en Belgique) ; du mot chablon (de l’allemand schablone), qui désigne un « pochoir » ; du mot stempf (et ses variantes : stemp, stempel, stempfel, le Dictionnaire suisse romand rappelle qu’on peut aussi les entendre en Alsace) qui désigne ce que l’on nomme en français commun un « tampon ». Mais c’est aussi le cas de l’emblématique verbe poutser (ou poutzer, de l’allemand putzen ; on trouve aussi l’expression faire la poutze), qui signifie grosso modo « faire le ménage » :
Boiler

Figure 1. Répartition et vitalité du mot boiler dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Stempf

Figure 2. Répartition et vitalité du mot stempf (et variantes) dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Chablon

Figure 3. Répartition et vitalité du mot chablon dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Poutzer

Figure 4. Répartition et vitalité du mot poutzer (et variantes) dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
La seconde série de cartes permet de montrer que si certains germanismes sont connus sur l’ensemble du territoire, ils n’ont pas la même vitalité selon le canton d’où sont originaires les participants de l’enquête. C’est notamment le cas du mot witz (qui désigne une « blague » ou un « gag »), de la tournure être à la strasse (où le mot strasse remplace le mot rue ; en France, il est possible d’entendre un jeune dire qu’il est « à la street », v. ce lien), du verbe schlaguer (qui signifie « taper, battre ») ou du mot moutre (la « mère » en langage familier ; pour le « père » on dit fatre, la carte – non présentée ici – est identique à celle de moutre). Comme on peut le voir sur les figures ci-dessous, c’est surtout dans les cantons de l’Arc Jurassien que l’on aura le plus de chances d’entendre ces germanismes, le canton de Fribourg se place en seconde position, les autres cantons cumulent des pourcentages plus bas :
Witz

Figure 5. Répartition et vitalité du mot witz dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Être à la strasse

Figure 6. Répartition et vitalité de l’expression être à la strasse dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Schlaguer

Figure 7. Répartition et vitalité du mot schlaguer dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Moutre

Figure 8. Répartition et vitalité du mot moutre <> dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Restent enfin les germanismes qui ne sont connus que dans une toute petite partie de la Suisse romande, en l’occurrence dans les cantons de l’Arc Jurassien. On pense aux verbes kotzer (« vomir »), petler (« mendier ») ou schneuquer (« fouiner, farfouiller »), mais aussi au substantif stöck (qui désigne un « bout de bois », et que l’on trouve également orthographié steck, stökre, stäkre ou encore chteucre) :
Kotzer

Figure 9. Répartition et vitalité du mot kotzer dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Schneuquer

Figure 10. Répartition et vitalité du mot schneuquer dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Petler

Figure 11. Répartition et vitalité du mot petler dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Stöck

Figure 12. Répartition et vitalité du mot stöck (et ses variantes) dans l’enquête sur les Germanismes. Chaque symbole représente le code postal de la localité d’enfance d’un ou de plusieurs participants, plus la couleur est chaude, plus le pourcentage de participants par département (FR) ou canton (CH) est élevé.
Quel français régional parlez-vous?
Cet article vous a plus ? L’enquête sur les germanismes est terminée, mais vous pouvez répondre à une autre enquête sur les mots et les expressions régionales du français, en cliquant ici. Vous nous aiderez ainsi à y voir plus clair entre ceux qui se sèchent avec un linge, un essuie, un drap ou une serviette (de bain); ceux qui cuisent l’eau et ceux qui la font bouillir ou encore ceux qui appellent un pamplemousse un grapefruit (ou inversement, ceux qui appellent un grapefruit un pamplemousse !)

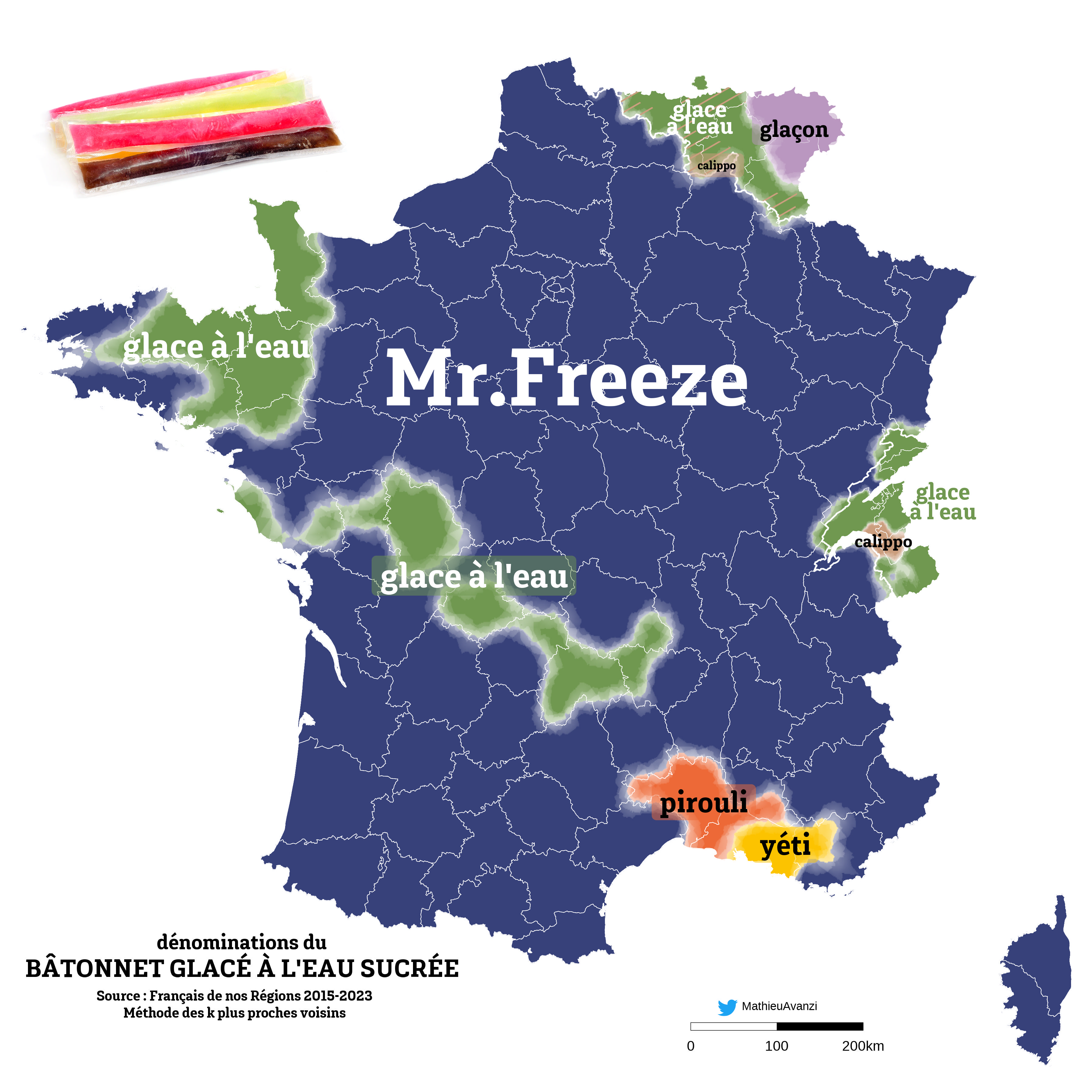
Je confirme l’usage de « boiler » en Belgique francophone (du moins dans l’est, ou l’influence germanique est la plus forte), cependant il se prononce « boilère » et non pas « boileur ».
Le boiler est très utilisé en Suisse, mais ça se prononce habituellement beu-ylère (variante plus francisée) ou le beu-y-l’r (version très germanisée)
un internaute m’a signalé par email quà boudry, chez ses parents, le boiler se prononçait “Beuler” 🙂 ! Décidément…
Et j’ajoute « schlinger » pour « puer ». Ca schlingue…… avec un long « iiiiiiiiingue » pourappuyer le fait.
CH 2000
Je confirme, signe et me rappelle plein de souvenirs de vestiaire de gym !!! Petite précision pour les « étrangers du dehors » : l’infinitif est « chlinguer ». Je m’en fiche du ch ou sch (puisque c’est du langage parlé) mais faut le u après le g car c’est un g comme GOLF et non comme JARDIN…
Complètement, j’étais distraite et pas moyen d’éditer sauf erreur de ma part 🙂
oui, chez nous aussi à Morteau on dit couramment « schliiiiiiinguer » pour « puer » et quand ça schlingue, c’est que ça pue vraiment !!!
Françoise
25500 MORTEAU
Schlinguer, putzer, schlaguer, spekr, schneuquer, tous des mots qui, premièrement ne s’écrivent pas et que deuxièmement je déteste entendre bien que je les connaisses. A votre avis est-ce qu’un Biennois francophone apprécie de voir tous les panneaux publicitaires, par exemple, de sa ville en allemand?
La cohabitation entre différentes langues sur un même territoire est parfois difficile… Les Suisses allemands ont aussi pris des expressions au français (merci, adieu, trottoir, etc.).
Je suis biennois francophone, les mots issus de l’allemand font partie du biElinguisme et ne me dérangent nullement, bien au contraire.
Et à quelques kilomètres de chez vous, on est monolingue. Vive le bilinguisme!
oui comme dit Maude, à quelques km de chez vous, on est « monolinguiste » à en pleurer ! un pays à 3 voire 4 langues (avec le romanche !) quelle richesse ! même si les suisses alémaniques n’aiment pas les suisses romands et vice versa…bah,c’est tout de même une richesse!
car n’oublions pas qu’une langue est une mécanique de précisions…oh, le Witz !
Françoise
Question vraiment stupide de ma part… Boiler, euh, n’est-ce pas, à la base, un anglicisme?
Il s’agit bien d’un anglicisme, en effet ! En Suisse, c’est l’allemand qui l’a emprunté d’abord,puis le français l’a pris à l’allemand, techniquement ça en fait donc un germanisme (!). On retrouve boiler au Québec et en Belgique, où il a été emprunté directement à ‘l’anglais
De quel mot allemand provient le mot ‘chablon’?
[Très fière de cette diversité! Merci de lui donner une visibilité!]
selon le dictionnaire suisse romand, ça viendrait de l’allemand « Schablone » (emprunté lui-même au néerlandais schampelun, qui signifie « échantillon »)
Bonjour! Alors tout d’abord, merci pour vos cartes, c’est génial. Je me demande toutefois pourquoi vous adoptez une posture aussi ‘puriste’. Les régionalismes, n’est-ce pas aussi une richesse de la langue? La mobilité de termes d’une langue à une autre, est-ce forcément toujours négatif?
Et qu’en est il du mot tableau –> tabelle ?
chez moi (provençale de toujours maintenant savoyarde du haut) c’est l’époisse qui shliingue et pas peu! ho ça oui mon brave!
Bonjour français « de souche « ,parisien, ayant vécu ds bien des endroits en France, puis bien des années au Danemark et j’ai tjrs utilisé » schlinger: » sans jamais avoir vécu en Suisse ,et de plus, à peu près très mes expression retenues sont également présentes en danois
Surtout parce qu’il y a un emprunt partagé de l’anglais et de l’allemand!